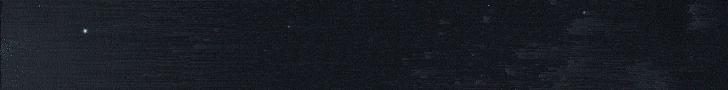Marcher le paysage : une autre analyse des territoires

De tout temps, la marche a constitué le principal moyen de déplacement de l’humanité. Mais depuis le début du XXe siècle, l’automobile — promesse de gain de temps — a peu à peu pris le pas sur cette pratique. Aujourd’hui, l’urgence climatique et la nécessité de limiter nos déplacements carbonés remettent la marche au cœur des projets d’aménagement, en particulier dans les zones urbanisées. Envisagée comme un objectif à atteindre pour les usagers de la ville, elle peut aussi être un point de départ tant elle constitue un outil naturel au service des professionnels permettant de prendre la mesure d’un lieu, d’en saisir les ambiances, de comprendre l’organisation de quartiers ou d’aller à la rencontre de leurs habitants. Parce que le rythme y est plus lent et que l’activité en elle-même incite à la réflexion — seul ou à plusieurs (entre acteurs du projet urbain: commanditaires, professionnels, usagers) — la marche permet une approche sensible du terrain, rompant avec les autres approches de l’urbanisme — tout en leur étant complémentaire — en s’inscrivant dans une dynamique d’engagement: «La présence “sur terrain” aide le marcheur à donner de la valeur aux choses qu’il croise et qui ne seraient pas visibles si le corps n’était pas présent, explique Nada Essid, urbaniste doctorante à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette. Cette pratique serait alors un moyen pour repenser les lieux de vies avec l’objectif de mettre en avant de nouveaux narratifs et récits» (1).
En achetant le numéro correspondant à cet article (Numéro 1), vous recevrez la version imprimée et aurez accès immédiatement à l'ensemble de son contenu en ligne.
Je m'abonne (11 numéros) / J'achète ce numéro Je me connecte