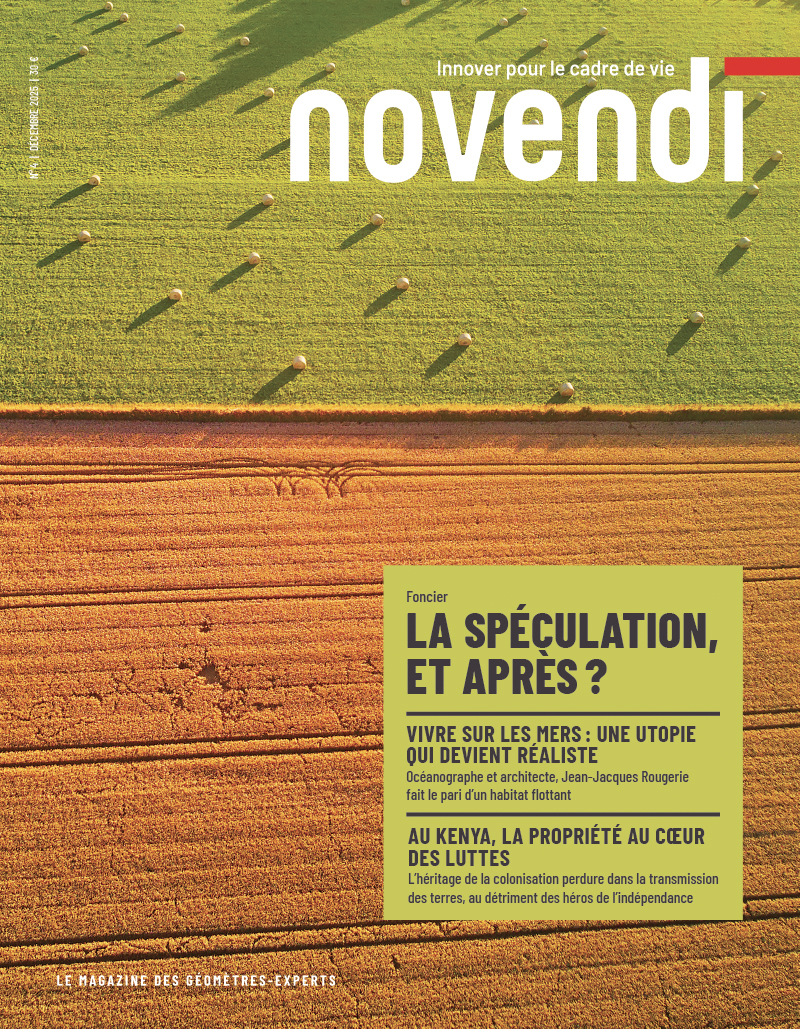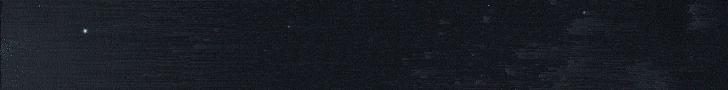Inondations : la nécessaire mobilisation

N’importe quelle image satellite suffit à le démontrer: l’eau domine le globe terrestre en occupant 71% de sa surface totale, soit plus de 361 millions de kilomètres carrés. Vitale pour l’ensemble des organismes peuplant la Terre, cette ressource peut aussi se transformer en une terrible menace. Amplifié par le dérèglement climatique, ce danger menace l’habitat humain et les infrastructures et peut se manifester sous quatre formes: inondations, ruissellement urbain, recul du trait de côte et remontées de nappes (lire ci-dessous). Quatre phénomènes qui dessinent à leur manière une nouvelle géographie des risques et qui contraignent les professionnels de l’aménagement à repenser leurs pratiques.
Les inondations concernent une commune sur trois et exposent directement au risque 18 millions d’habitants (source Géorisques). Un danger pris très au sérieux par les autorités: 74,4% de la population résidant dans une zone exposée à l’aléa inondation par débordement de cours d’eau est aujourd’hui couverte par un plan de prévention des risques inondation (PPRI). Cinq régions sont plus particulièrement menacées: Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Grand Est. Localement, les élus travaillent à trouver des solutions avec les populations. Les professionnels de l’aménagement, eux, apportent leur expertise afin de modifier des habitudes parfois profondément ancrées. «Le changement climatique entraîne non pas plus de pluie, mais des épisodes plus intenses et plus concentrés, observe ainsi Fabien Palfroy, géomètre-expert. Ces épisodes pluvieux deviendront de plus en plus fréquents, ce qui nous oblige à anticiper des événements plus extrêmes.»
Autre facteur de risque: l’imperméabilisation des sols urbains. En France, 9,5% du territoire est artificialisé, avec des taux d’imperméabilisation atteignant 80% dans les centres-villes. Cette imperméabilisation multiplie par un facteur allant de cinq à dix les débits lors des épisodes pluvieux intenses. Les événements de ruissellement urbain, eux, ont doublé en fréquence depuis 2000. La ville de Cannes a reçu, en octobre 2015, 194mm de pluie en 2h, celle de Morlaix 70mm en 1h, au mois de juillet 2018. A chaque fois, les réseaux d’assainissement, dimensionnés pour des pluies décennales comme c’est le cas dans 40% des communes françaises, ont immédiatement saturé.
 © Lulu Berlu / Adobe Stock
© Lulu Berlu / Adobe Stock
RECUL DU TRAIT DE CÔTE ET REMONTÉES DE NAPPES
Sans doute la conséquence la plus emblématique du risque lié à la montée des eaux, le recul du trait de côte est aujourd’hui une urgence. En juillet dernier, lors des Assises nationales de la sobriété foncière, Gonéri Le Cozannet, ingénieur BRGM à l’unité «Risque côtier et changement climatique», lançait un avertissement: «Il n’y a pas de solution miracle. A court terme, on peut réduire la vulnérabilité des bâtiments et éviter de construire, mais au-delà de 30 ou 40cm d’élévation au niveau de la mer, ce ne sera plus suffisant. A long terme, il n’y a que deux solutions: soit on recule, soit on protège». Sur les 5.500km de littoral français, 24% connaissent une érosion active, menaçant directement plus de 500 communes côtières. Le rythme moyen de recul atteint 50cm par an sur la côte atlantique et 20cm sur la côte méditerranéenne, avec des pics à 2m par an sur certains secteurs dunaires de Nouvelle-Aquitaine. La Camargue, elle, peut enregistrer une érosion atteignant 5m par an selon les secteurs. Partout, le phénomène s’accélère: les mesures satellitaires révèlent une multiplication par 2,5 du rythme de recul depuis 1950. Dernier phénomène, longtemps sous-estimé, les remontées de nappes affectent potentiellement 1,2 million de Français dans le Bassin parisien, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime. Fissuration des fondations, instabilité des ouvrages souterrains, inondations de caves et sous-sols: la menace est très sérieuse.
Ces quatre risques contribuent à redéfinir les stratégies d’aménagement. Les plans de prévention des risques évoluent ainsi vers des approches multi-aléas: 47% des nouveaux PPR intègrent désormais plusieurs types de risques hydriques. Un chiffre qui illustre une nouvelle réalité: désormais, tout projet doit prendre en compte les risques liés à l’eau, qu’elle arrive du large, qu’elle jaillisse de terre ou qu’elle quitte le lit des cours d’eau.
Quatre risques majeurs
Une inondation correspond à la submersion temporaire de zones habituellement hors d’eau. Elle peut être la conséquence de différents types d’événements.
Le débordement: le cours d’eau sort de son lit à la faveur d’une crue et peut inonder les terres alentour.
Le ruissellement urbain: lors de précipitations très intenses en ville, l’eau ne s’infiltre pas dans le sol car ceux-ci sont imperméables. Les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales sont saturés. Les eaux de pluies empruntent alors les rues, avec des courants parfois dangereux, jusqu’à rejoindre une rivière ou un autre réseau d’évacuation.
La remontée de nappe: ce type de phénomène se produit lorsque la nappe phréatique sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues. Les remontées de nappes peuvent provoquer l’inondation de caves et engendrer l’endommagement du bâti, notamment du fait d’infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers.
La submersion marine: sur le littoral, des conditions météorologiques et océaniques défavorables (souvent accompagnées d’une forte houle et d’un vent fort venant du large) peuvent entraîner une hausse du niveau marin et inonder les zones côtières.
(Source: Géorisque)
À LIRE AUSSI
• Solutions locales pour désordre global
• «Notre double compétence est particulièrement adaptée à la gestion de ce risque»
• Géomètres-experts et technologies de pointe
• Trait de côte: le Cerema au soutien des collectivités
• Aux Pays-Bas, une culture de l’inondation
Retrouvez ces articles et l’ensemble du dossier consacré aux risques liés à l’eau dans le magazine Géomètre n°2236, juin 2025, en consultant notre page «Le magazine».