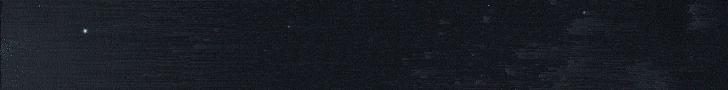Ponts et viaducs : patrimoine sous pression

Nous les franchissons chaque jour. Nous roulons dessus, passons dessous, sans réellement nous soucier de leur état. Pourtant, nos ponts et autres viaducs souffrent. Un peu à l’image de nous autres, humains, ils encaissent le passage du temps et ont besoin d’être régulièrement révisés. Désormais, ils doivent aussi affronter un dérèglement climatique qui accroît la pression: écarts de température, crues exceptionnelles, vents violents, sécheresses prolongées. Confrontée à l’effet ciseau engendré par la conjonction d’un parc vieillissant et de moyens financiers insuffisants, la situation d’un certain nombre de nos ouvrages d’art est grave. Mais, pour reprendre l’adage populaire, est-elle pour autant désespérée?
A priori, le risque d’une catastrophe comme celle qui a endeuillé la ville de Gênes en 2018, avec l’effondrement du pont Morandi, semble écarté. Mais de fortes inquiétudes subsistent. En mars 2024, lors d’une table ronde organisée au Sénat, Pascal Berteaud, directeur général du Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), s’était montré sans détour: sur 45.000 ponts examinés, 10% nécessitaient selon lui «des mesures de sécurité immédiates» et 4%, «en raison d’un désordre grave de structure», risquaient littéralement de «se casser la figure».
UN CHANTIER D’UNE AMPLEUR CONSIDÉRABLE
Face au risque, tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources. Les moyens manquent aux collectivités, et en particulier aux communes. Les grands gestionnaires d’infrastructures, comme les sociétés d’autoroutes ou SNCF Réseau, surveillent pour leur part étroitement leurs ouvrages. Ils peuvent pour cela s’appuyer sur leurs propres moyens ou recourir aux services de sociétés spécialisées dans la mesure, les relevés et le suivi de la stabilité des structures — des prestations proposées également par certains cabinets de géomètres-experts. Si les fondamentaux de l’auscultation ont peu changé, l’apport du scanner 3D et le développement du suivi automatique ont fait entrer la surveillance des ouvrages d’art dans une nouvelle ère. Charge ensuite aux bureaux d’études de traduire ces données en actions concrètes de confortement et de mise en sécurité. Ces acteurs privés, maillons essentiels de la chaîne de résilience, jouent un rôle clé dans la consolidation et la remise en état d’un patrimoine dont la sécurité dépend de leur expertise. Ainsi, dans la nuit du 13 au 14 octobre dernier, les experts du groupe Geofit ont ausculté les 3.356m du plus long pont de France, entre Saint-Nazaire et Saint-Brevin-les-Pins. L’ouvrage, qui fête cette année ses cinquante ans et qu’empruntent quotidiennement 33.500 véhicules, a fait l’objet de relevés altimétriques et d’une analyse complète de ses rivets.
 Le pont de Saint-Nazaire enjambe l’estuaire de la Loire. © Aurelien / Adobe Stock
Le pont de Saint-Nazaire enjambe l’estuaire de la Loire. © Aurelien / Adobe Stock
Le pays a également la chance de pouvoir disposer avec le Cerema, établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, d’un acteur public de référence. À travers des opérations comme le Programme national ponts (PNP), il permet ainsi aux décideurs de disposer d’une connaissance actualisée de l’état du parc et d’un appui méthodologique précieux. Fortes de ces données, les collectivités peuvent hiérarchiser les priorités, planifier les travaux les plus urgents et, le cas échéant, solliciter un soutien financier de l’État.
Dans un pays où les ponts se comptent par centaines de milliers mais les crédits par poignées, le chantier reste d’une ampleur considérable. La transformation des usages, liée à la transition écologique, peut être l’une des solutions pour maintenir des ouvrages altérés par le temps et devenus impropres à leur usage premier. Mais, au-delà des interventions, la solidité des ouvrages tient parfois à peu de chose: une conception suffisamment robuste, un diagnostic réalisé à temps, une décision budgétaire avisée, une météo apaisée. C’est aussi la somme de ces éléments qui, en complément d’un effort global, permettra d’éviter en France un drame à la génoise.
140 M€
C’est, selon le Cerema, la somme nécessaire à l’entretien annuel des ponts communaux.
À LIRE AUSSI
• «Produire une donnée incontestable pour que les gestionnaires puissent décider»
• Le Cerema, une sentinelle au chevet des ponts
• La météo se déchaîne, les structures encaissent
• À Gènes, un drame et une renaissance
Retrouvez ces articles et l’ensemble du dossier consacré à l’entretien des ponts et viaducs dans le magazine novendi n°3, novembre 2025, en consultant notre page «Le magazine».